Intervention de Pierre-Didier Tchétché – Rapport égalité femmes-hommes
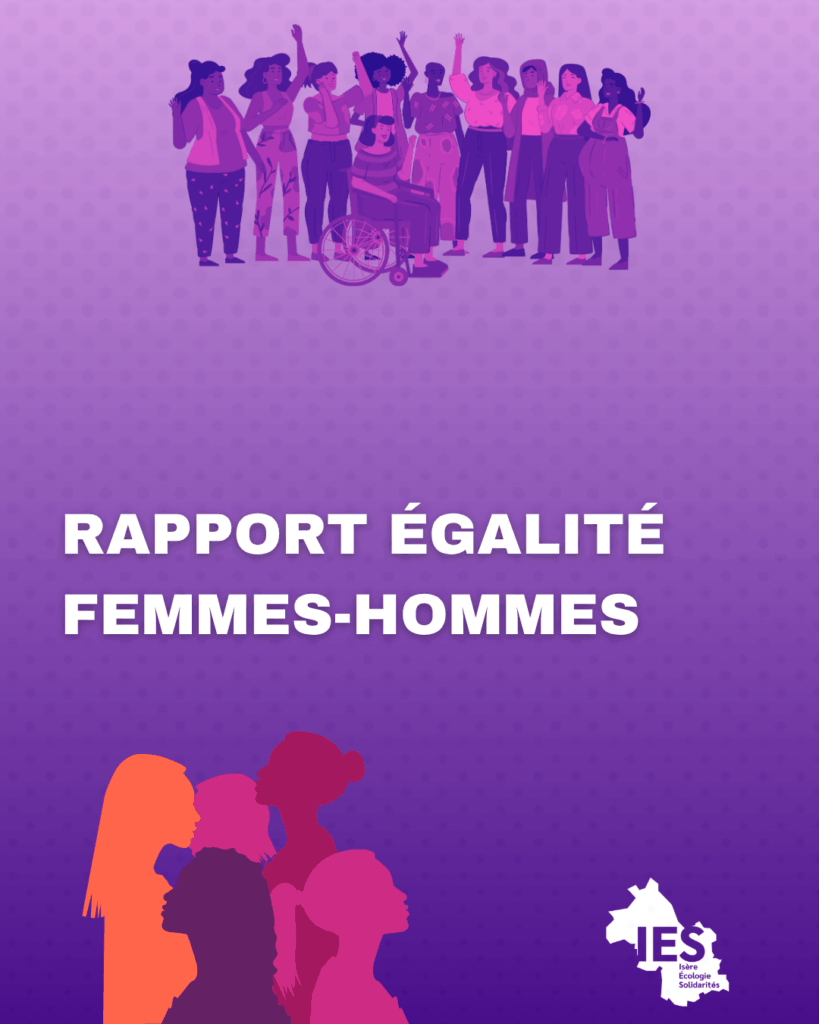
Égalité interne : des résultats encourageants
Le rapport égalité femmes-hommes interne à notre institution départementale reste un outil précieux d’évaluation. Nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises.
Nous constatons de nouveau, avec satisfaction, les bons résultats du Département. L’index d’égalité professionnelle progresse. L’écart salarial, bien qu’un peu défavorable aux agentes contractuelles, reste positif pour les femmes titulaires.
Sur le plan interne, ces avancées sont réelles. Elles montrent que les efforts portent leurs fruits. Elles confirment aussi que les politiques volontaristes produisent des résultats mesurables.
Inégalités territoriales : une réalité persistante
En revanche, lorsque l’on observe la situation à l’extérieur de notre institution, dans le territoire de l’Isère, la réalité est plus préoccupante. Beaucoup reste à faire pour l’accès au logement, à l’emploi et aux soins. Les conditions de vie des familles monoparentales demeurent difficiles. Une part importante de ces familles vit sous le seuil de pauvreté.
Pour répondre à ces constats, il faudrait déployer des moyens sur l’ensemble du Département. Les territoires les plus fragiles devraient être prioritaires. Dans ces zones, les femmes sont souvent en première ligne. Elles font face à des situations multiples et complexes, cachées derrière la précarité.
Dans ce contexte, une question se pose. Comment expliquer le désengagement du Département d’une politique publique comme la politique de la ville ? L’une de ses vocations est pourtant la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les territoires. Nous avons signé les contrats de ville, mais sans y associer les moyens nécessaires.
En Isère, 24 territoires sont concernés. Ils représentent 10 % de la population. Quatorze d’entre eux se trouvent en dehors de la métropole grenobloise. Ces quartiers, souvent absents des débats, concentrent pourtant des enjeux sociaux urgents.
Nous avions proposé une mission d’information et d’évaluation pour améliorer la lutte contre les précarités. Ces précarités génèrent de la déconsidération et un sentiment d’infériorité. Elles entraînent, au final, une dégradation de la dignité. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
La politique de la ville : un levier ignoré
Le devoir de solidarité aurait dû nous conduire à voir la politique de la ville autrement. Elle n’est pas un simple outil. C’est une composante essentielle de l’action sociale. Elle offre une réelle opportunité d’innovation sociale.
Elle permet de traiter des problématiques lourdes avec des approches nouvelles et expérimentales. Ce devrait être un intérêt majeur pour le Département, qui couvre des territoires variés, y compris des zones rurales et périurbaines.
Les données confirment l’ampleur des enjeux. Selon l’INSEE, l’accès au marché du travail est encore plus difficile pour les femmes vivant en quartiers prioritaires. Il l’est davantage que pour celles résidant dans des intercommunalités comportant au moins un QPV. Les familles monoparentales, plus fréquentes en QPV, sont très majoritairement dirigées par des femmes.
Les femmes seules, nombreuses et souvent plus âgées que les hommes seuls, sont davantage touchées par la pauvreté dans ces quartiers.
Pourtant, on observe aussi des dynamiques positives. Par exemple, les QPV présentent une création d’activités plus forte que la moyenne. De nouvelles formes d’économie y émergent : numérique, collaborative ou sociale et solidaire. Dans ces domaines, les notions de territoires et de réseaux évoluent. Les acteurs économiques traditionnels restent cependant peu présents, hormis le secteur de l’insertion.
Une autre proposition mérite attention. Notre collègue Thierry Badouard l’a avancée en commission d’appel d’offres : instaurer la parité comme critère d’éligibilité dans les marchés publics. Cette idée pourrait renforcer nos engagements.
Conclusion : transformer l’engagement en action
Assumer une parité réelle, en interne comme en externe, peut devenir un levier puissant de transformation pour le Département. La politique de la ville pourrait servir de modèle pour consolider nos obligations et renforcer notre action.
En tant que chef de file de l’action sociale, le Département a un rôle central. Pourtant, malgré la signature des contrats de ville, les moyens supplémentaires manquent.
À quoi sert un engagement inscrit sur le papier s’il ne se traduit pas en actions concrètes ?
